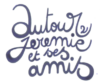notre histoire
partie 2
1997/99 à 2007 : L'AGE DES PROJETS

DE L'INTEGRATION SOCIALE A L'ACCUEIL TEMPORAIRE

1997-99 Le premier projet : l’intégration sociale par le support d’un centre social
Le contexte
L’école arrive à son terme. Qu’est ce qu’il va se passer pour Jérémie? Vers où se tourner ? Qui interpeler ? Pourquoi ?
Par l’infrastructure scolaire publique qui l’a accueilli pendant 11 ans, Jérémie a baigné dans un environnement bienveillant, joyeux, stimulant, porteur. Il va falloir faire preuve d’imagination pour trouver un ailleurs, une ou plusieurs autres infrastructures dans lesquelles Jérémie avec ses accompagnateurs pourraient se glisser … il va falloir peut-être créer de toutes pièces une prise en charge dynamique qui nous ressemble … sans ressembler probablement à rien d’existant. Difficile pari !
C’est alors, portée par l’association, une foison de projets qui démarrent, s’oublient, se reprennent, bifurquent pendant une dizaine d’année (1997 – 2007)
Les premiers écrits n’étaient pas dénués de sens et restent pertinents encore aujourd’hui … 27 ans plus tard !
- de 14 à 16 ans : c’est la scolarité obligatoire ; il faut donc que l’école spécialisée ou non assume sa tache. Il est tout à fait normal de prévoir pour ces enfants un rythme différent ainsi qu’une aide éducative complémentaire
- de 16 à 18 ans : c’est l’apprentissage de la vie professionnelle pour certains, sociale pour tous. Nos contacts dans le quartier nous ont amenés à privilégier comme lieu de rencontre le centre social du quartier. Lieu de brassage par excellence qui a aussi le mérite de proposer des activités très variées. Ces jeunes (tous les jeunes ?) doivent être acceptés dans ce cadre avec intervention d’une aide éducative spécifique. Cette présence sera intéressante pour ces enfants dans un esprit d’ouverture, de découverte et de culture au sens large. Elle le sera pour les adultes pour leur permettre de découvrir réellement ce qu’est handicap et finalement la richesse de ces enfants pas comme les autres. Il y a en chacun de nous un handicapé. Il serait sage de le reconnaitre et ces rencontres devraient mettre davantage d’humanité dans les rapports entre les gens qui ne se sentiraient peut être pas obligés de cacher à tout prix leurs limites
- de 18 à 21 ans : C'est la période où le jeune qui souffre d’un handicap va être préparé à trouver sa place dans la société. Il ne pourra le faire seul et c'est évidemment le questionnement du monde de la vie active qui doit conduire à faire une place à ceux qui ne vivent pas à notre rythme mais qui ont leur place et sans conteste leur rôle à jouer. Nous avons le souhait de sortir des concepts d’exclusion, d’insertion sociale qui ont été galvaudés et qui ne correspondent plus à rien dans une société où les valeurs sont à réinventer. Notre projet, ambitieux certes, mais tout à fait réaliste est de susciter, encourager, développer une interaction entre les gens "autonomes" et ceux qui ne le sont pas afin que chacun tire un enseignement de ces rencontres. Elles seront instructives pour les deux parties. Le mieux est de prendre des exemples: * Un lieu d'accueil de handicapés peut se rendre dans une classe, qui a réfléchi de façon théorique sur le handicap pendant un trimestre, et ce régulièrement pendant une semaine. Ce serait le tiers temps "handicap". * Un groupe de personnes âgées peut rendre visite à ce groupe d'enfants et venir chanter des chansons ou prévoir une après-midi dansante *Les jeunes peuvent se rendre individuellement ou à deux au Centre Social et se joindre aux activités existantes. Les jeunes seront toujours accompagnés par des éducateurs. Certains volontaires en cours de formation pourraient venir assurer des permanences ponctuelles. ( …) »
Ils parlent de sociabilisation pour leur enfant, ils ont des projets et des désirs, comme tous les parents, ils ont même pour objectif que Jeremy apporte sa part à la vie sociale qui I ‘entoure. Ses parents mettent en avant la priorité de vie qu'ils ont choisie pour eux et leur famille.
Quelle audace !
Cette évidence, nécessaire à tous les enfants pour grandir, d'avoir des parents qui ont de l'ambition pour eux, parait, parce que Jeremy est handicapé, une douce utopie. C'est pourquoi le projet d'Annick et Henri de proposer la présence de Jeremy dans un centre social, avant de voir les difficultés, m'a enthousiasmée.
D'abord parce que Jeremy s'inscrit dans la dynamique de sa famille. Ensuite, d'une échéance pénible comme la fin de la scolarité, encore une fois ses parents nous font la démonstration que tout peut être transformé positivement.
Que peut faire Jeremy dans ce contexte ?
Etre lui-même (comme on aimerait que tout le monde soit). Par ses manques, sa bizarrerie, sa gentillesse tranquille, d'autres apprendront la différence et toute la diversité humaine. Jeremy peut être celui qu'on retrouve, le repère dans une journée trop chargée, celui dont on n'attend pas grand chose mais qui par sa présence donne de la valeur à notre vie. Jeremy n'a plus sa place à l’école, reflet de la société qui court pour produire, mais II a sa place dans une maison de quarter où chacun vient de son plein gré retrouver une activité, des amis, une chaleur, de la poésie et vivre sa philosophie (…).
Quand au local, (annexe) si c'est pour s’y refugier quand Jeremy n'est pas à sa place dans le centre, je dis non. Si c'est pour matérialiser la présence de Jeremy, et pour ouvrir la porte vers un lieu de réflexion, de paroles et d'accueil vers les autres, alors, oui, il a son utilité. Bien sûr il faudrait salarier l'accompagnateur qui pourrait être 2/3 de son temps auprès de Jeremy et 1/3 travailler sur des projets avec des écoles, des associations qui pourraient partager un vécu avec Jeremy.
Je termine par une note personnelle pour dire tout l'enrichissement que m'apportent les enfants présentant un handicap avec qui je travaille; j'aimerais que d'autres puissent profiter et partager l'excitation des projets, les mimiques dignes des meilleurs acteurs, les peines qui posent les vrais questions, la remise en question permanente de notre façon de faire et de les aborder, la tolérance et l'imagination qu'ils créent autour d'eux."
Resituons nous dans le temps : en 1997, l’Etat élabore un programme de développement d’activités pour l’emploi des jeunes. Il faut faire des propositions, innovantes, qualifiantes. Une campagne de recrutement va avoir lieu.
Forte de nos réflexions et de cette opportunité nous constituons notre premier dossier !
Résumé du projet
L’heure n’est plus pour les personnes handicapées au « tout institutionnel »
- trop cher
- trop lourd à gérer
- qui n’est plus porteur d’une valeur de rédemption, de sauvetage, par rapport à un milieu familial perçu comme pathogène
- qui commence à entrevoir de nouvelles demandes sociales plus ouvertes à l’autonomie, au droit et à la liberté de la personne handicapée
Pour autant l’heure n’est plus non plus au « tout familial »
- qui déséquilibre, dégrade les relations familiales, pouvant à la longue conduire au rejet du sujet
- ou au contraire qui essouffle, étouffe, marginalise la cellule familiale toute entière
Mais alors comment garder du sens à la prise en charge et à la vie de cet enfant gravement handicapé ?
Quand les compétences intellectuelles, manuelles, motrices sont gravement réduites, demeurent et peuvent toujours s’exprimer, s’exercer et se développer des compétences relationnelles; à la condition que la communication soit soutenue, reconnue, opérante pour créer du lien et de l’humain
C’est dans les interstices laissés libres par les grandes institutions qu’il va falloir chercher et continuer à procurer à l’adolescent les occasions d’une véritable vie sociale pour qu’il poursuive son processus de socialisation, qu’il continue à se risquer au contact des autres, à s’épanouir, à apprendre de l’autre (et … à donner aussi de sa tendresse et de son innocence)
Les centres sociaux de quartier sont des infrastructures locales, bien repérées et riches en échanges les plus larges offrant de larges possibilités d’une vie et d’une intégration sociale : organisation, structuration, fidélisation de liens,
dès lors qu’un véritable travail de réflexion, de préparation et d’accompagnement est mené, régulièrement et dans le temps, la palette des activités est importante,
- avec ses pairs, l es plus jeunes (centres aérés, sorties, camps … ) mais aussi activités plus construites et suivies, où on acceptera simplement de la personne handicapée , son plaisir d’être là, de regarder, d’écouter, de vibrer …
- avec les plus âgés (clubs de gym, 3° âge …) dans le même esprit
- avec les permanents qui structurent et font vivre ces lieux : rencontres brèves mais régulières, témoignant, par leur accueil, d’une reconnaissance et d’une place à part entière de la personne handicapée dans la vie du centre
- avec tous les participants réguliers ou occasionnels : moments récréatifs, repas, soirées, fêtes … où se créent un moment d’histoire d’une cité, un sentiment d’appartenance à un quartier
Pour ce, nécessité de la présence d’un accompagnateur « rodé » tout autant au problème du handicap, qu’aux rouages et à la dynamique d’un centre social et de son tissu environnant :
- travailler et préparer en amont, avec l’équipe d’encadrement, les différents intervenants, participants …
- accompagner physiquement les rencontres, expliquer, rassurer, solliciter, encourager …l
- évaluer les situations, aménager, réajuster les moments de présence, les modalités de participation …
Mais parallèlement à cet accompagnement dans le quotidien, il devra aussi réfléchir et travailler pour donner UNE FORME à cette expérience et la rendre ainsi pérenne, et pourquoi pas transposable : élargissement du « public », implication des partenaires, formalisation d’un cadre …
Seul un professionnel situé sur l’axe éducateur/médiateur social/opérateur de projet pourra assumer et réussir cette tâche d’accompagnement, de médiation, d’innovation sociale. S’agissant d’un poste de travail qui correspond à un besoin à la fois émergeant et non satisfait, il pourra être mis en place dans le cadre d’un emploi jeune et effectivement créé dès l’accord du projet.
On pourra imaginer une extension du projet vers la création pour de jeunes handicapés, de mini-structures d’accueil alternatif (temporaire et/ou partiel), intégrées à des centres sociaux
D’un côté réponses souples de proximité aux besoins de relais, de stimulations
D’un autre côté, développement local, économique et social dans les quartiers, permettant de développer de nouvelles solidarités, de nouvelles activités
Notre projet, qu’il s’agit de continuer à travailler et pour lequel nous sollicitons une aide technique (étude de faisabilité et aide au montage) est de mettre en place, pour de jeunes handicapés, une (ou plusieurs …) petite unité d’accueil temporaire ou intermittent s’appuyant sur un centre social ou une maison de quartier
Petite unité d’accueil installée dans ou à proximité du centre social, dans des locaux qui pourraient être, en fonction des moments, partagés
Petite unité
- de taille humaine et à effectif variable, capable d’une grande souplesse et adaptabilité, pouvant répondre aux situations particulières d’urgence et aux demandes individuelles construites
- proposant des prises en charge ponctuelles ou régulières, à temps variable, servant de lieu d’attente, lieu relais, lieu médiation, lieu rupture ou lieu de vie simplement
- privilégiant les activités de bien-être, de plaisir, de relations, de partage, sans méconnaitre les activités éducatives et pédagogiques
- respectueuses des difficultés et des besoins de l’enfant mais surtout de son projet de vie et celui de sa famille, ou facilitateur pour construire justement un projet de vie
- faisant une large place aux familles (celles-ci constituant l’assise permanente et durable pour la personne handicapée dans une vie faite souvent de succession de lieux de prise en charge et de vie, favorisant particulièrement l’accueil, l’écoute, le soutien, l’accompagnement des parents fragilisés, mais aussi leur participation et leur implication
- fonctionnant en partenariat
Ces réponses voulues souples, à géométrie variable, inscrites au cœur d’un quartier et de son pôle d’échanges soulèvent inévitablement des difficultés qui, une fois dépassées constitueront aussi un élément de richesse.
Quelles difficultés :
- diversité de l’accueil, en termes d’âge, de handicap, de besoins, de démarches, de temps et de durée de prise en charge : comment harmoniser des interventions pour une population hétérogène ?
- difficulté de gestion alors que dans la définition et l’objectif même du projet, la population prise en charge n’est jamais captive
- la pluralité des partenaires ; les familles – toutes dans des cheminements différents – les professionnels en exercice … et ceux en recherche de réponses pour le compte de « leurs clients » , les intervenants du centre social …
- les ressources : prix de journée ou diversification plus aléatoire mais dynamique des ressources : cotisations, participations, subventions, fonds de solidarité …
- le cadre légal : quelle législation s’applique, quelles normes de sécurité ?
- le risque, à éviter, de devenir un bouche trou, un palliatif à une carences d’institutions spécialisées
ce projet présente un caractère d’utilité sociale. D’ailleurs l’accueil temporaire, tout simplement, de personnes handicapées, semble se réfléchir actuellement en différents endroits de France et une commission travaille sur ce sujet en prévision de la prochaine révision de la loi de 75. Il ne semble pas exister, à notre connaissance, sur Marseille, un groupe de réflexions à ce sujet , ou une expérience de se style ouverte
Résultat
1997… notre dossier reste lettre morte au niveau du programme d’état générateur de notre projet…
et puis on oublie un peu … Jérémie a 14 ans mais, contre toute attente, il repart à l’école …
1999 … On lance bien une première réunion ouverte sur le quartier. Mais c’est notre projet, qui n’a reçu aucun aval de l’état. Et le Centre Social, avec surement d’autres projets, motivations, obligations … ne s’en empare pas
Ce projet est-il utopique ? Sans fondement ? Déconnecté de la réalité ?
Non pas du tout : il est dans l’air du temps, s’inscrit totalement dans les idées de l’époque des politiques sociales sur les nouvelles formes d’accompagnement et de réponses souples, diversifiées et de proximité à apporter aux personnes en difficulté
Projet sans porteurs de projets ?
Sûrement : Projet complexe à visée large, véritable construction formelle, besoin de juristes et de comptables, de bâtisseurs et de promoteurs… que nous ne sommes pas, que nous n’avons pas
Et puis relais difficile à passer pour nous, parents, toujours un peu égoïstes et centrés sur la réponse à nos propres besoins immédiats, toujours frileux et méfiants surtout vis à vis des grandes institutions patentées, qui ont, elles , le potentiel pour aider à la réalisation de telles initiatives …Projet au point mort, qui trouvera peut être des opportunités ? Ou qui se fondera dans un projet similaire déjà en marche ? Ou qui sera la première marche sur laquelle on se hisse pour avancer ?
2000-2002 -Deuxième projet : l’idée d’un accueil temporaire
Le contexte
Voilà que ça nous reprend …
ou voilà que ça nous poursuit plutôt.
Jérémie est parmi nous qui attend ! Quelle place entre le tout famille et le tout institution …
Toujours dans l’esprit initial de favoriser des réponses intégratives, évolutives, souples, au plus près des besoins des personnes handicapées et de leurs familles, nous formulons le projet de créer un lieu d’accueil temporaire pouvant recevoir 8 adultes handicapés pour des séjours de 1 à 21 jours renouvelables.
Mais cette fois on adhère au GRAPH à Paris qui vient de se créer (groupement de réflexion et réseau pour l’accueil temporaire des personnes handicapées) et on se rapproche d’un service mis en place par le Conseil Départemental : INTERPARCOURS 13, qui réunit toutes les associations du département en vue de créer des synergies. Participation intensive des « 2 Annick » qui bossent à fond le projet
PROJET DE CREATION D’UN SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE POUR ADULTES HANDICAPES
Résumé du projet
L’accueil temporaire est pensé aujourd’hui comme un dispositif original particulièrement adapté aux besoins sociétaux actuels
Citons ici Mr Henri Jacques STIKER, sociologue et historien du handicap :
« L’accueil temporaire (…) tend à offrir des passerelles, à décloisonner, à produire des allers-retours entre famille, société civile, spécialistes. I s’agit d’alléger la route, des enfants comme des familles, pour que tout le monde ait l’énergie de la poursuivre, sans succomber sous le poids et sans être obligé de passer par une institutionnalisation lourde (…)
Le drame de nombre de personnes est, soit de ne plus avoir de lieux d’enracinement, elles sont donc désaffiliées, ou à l’inverse d’être incapable de circuler et de vivre autrement que dans une sorte de ruralité complètement dépassée. L’alternative aux institutions ou à la famille que représentent les lieux d’accueil temporaires me parait pouvoir répondre à cette nouvelle donne : être enraciné mais être mouvant, échapper aux lieux qui, par leur caractère institutionnel, risquent d’être enfermants, statiques, routiniers, et de ne pas correspondre à la modernité (…) de la libre circulation, mais sans se trouver dans des non-lieux déshumanisés, de consommation, de transit ? Avoir des lieux habités mais variés »
Citons ici le GRATH
« L’accueil temporaire pour les personnes handicapées s’inscrit dans une évolution des besoins et dans le cadre d’une diversification nécessaire des réponses.
C’est l’outil qu’il faut renforcer aujourd’hui pour accompagner la politique d’intégration et de maintien à domicile souhaitée par tous, la réalisation des projets personnalisés et pour en faire un véritable maillon de la chaine de solidarité créée par la loi de 75.
Chaque personne ,quels que soient son âge et son handicap doit pouvoir s’exprimer et bénéficier du choix de son mode de vie
(…) les structures d’accueil temporaire doivent contribuer au développement de formules souples, modulables, innovantes, dans et hors du champ médico-social, au service des personnes handicapées et de leur famille »
Et son président, JJ Olivin, dans les ASH du 15/10/1999, le justifie :
« La meilleure source d’économie dans le domaine du handicap, c’est de pouvoir compter sur une famille forte, capable d’accompagner au mieux la personne handicapée. Chaque fois qu’on tarde à la relayer et à la soutenir, on prend le risque de voir les situations se dégrader.(…)
L’accueil temporaire permet, selon les cas
- un séjour de loisirs simplement
- un séjour relais en réponse à une situation particulière, urgente ou non, nécessitant un rupture (épuisement, dérive, débordement), émanant de l’un ou l’autre des partenaires (personnes handicapée, famille, institution)
- un séjour test ou préparatoire à une séparation plus longue ; l’accueil temporaire accompagnerait l’idée d’évolution dans les différentes étapes de la vie de la personne handicapée
L’accueil temporaire offre une réponse plurielle (loisirs, projet individualisé, restauration de la personne) à un sujet singulier, en quelque sorte du sur mesure, s’inscrivant dans un cadre de proximité, au service d’une idée d’intégration.
Les idées forces du projet (NB : largement développées dans le document initial, avec références et exemples)
- un lieu de vie : un lieu où l’on vit, dans un cadre agréable, accueillant, chaleureux, où la personne accueillie est plus importante que son handicap
- un lieu ouvert où sont favorisés les échanges à l’intérieur et avec l’extérieur, où l’on recherche et l’on valorise les occasions qui permettent toutes les rencontres, et avec elles, le développement de ses compétences relationnelles et l’extension de sa socialité
- une équipe impliquée, constituée de professionnels qualifiés, adhérant au projet, acceptant de s’y engager pleinement (- diversité des qualifications, des spécificités et compétences, -partage des tâches en polyvalence pour éviter l’aliénation dans une fonction – formation permanente, tutorat et accueil de stagiaires – vigilance à ne pas se placer dans la toute puissance d’un statut ou d’un titre, – reconnaissance d’un responsable, « praticien » lui aussi de l’accueil mais également garant de la planification, de la cohérence et du respect des contrats
- une mixité de la population accueillie, l’hétérogénéité comme richesse
- une amplitude volontairement délimitée de fonctionnement : introduction de coupures régulières, rythmées et systématiques dans le fonctionnement comme des pauses régénératrices (ex : toutes les 21 jours)
- une coupure pour les personnes handicapées dans une trajectoire planifiée : temps de repos, temps de plaisirs où la rééducation se met, autant que possible entre parenthèses
- un lieu repère, ressource, poumon d’oxygène, tant pour la personne handicapée qui peut revenir que pour sa famille (écoute, informations, soutien)
- une pédagogie : charte, harmonisation par évaluation et régulation, gestion communautaire de la vie quotidienne, ouverture, partenariat
- un projet ouvert, des idées pas figées : ex : avant chaque fermeture, organisation d’une soirée restau-rencontre ouverte à tous (soirée de présentation, de retrouvailles de projet, de débats … ) – Participation à des manifestations citoyennes (ex avec des écoles qui travaillent sur le handicap) …
Caractéristiques de fonctionnement :
- population accueillie : adultes 18-60, femme/homme, tout handicap sauf sujet en crise (psychiatrie) ou surmédicalisés, Marseille et villes voisines, en donnant la priorité aux adultes ne bénéficiant d’aucune prise en charge
- modalités d’admission : on pourrait idéalement imaginer que soit alloué chaque année à chaque personne handicapée, un quota de » chèque séjour » ou chèque « journée d’accueil » (maximum 42 jours par exemple) dont elle disposerait librement et qu’elle négocierait sans intermédiaire. Cette hypothèse reste ouverte. En attendant, convention tripartite de placement temporaire entre le Conseil général, la structure, la personne ou son représentant
- modalités des séjours : séjours de loisirs, de ruptures, pouvant être programmés, préparés, contractualisés – total 6 places pour des séjours qui en aucun cas n’excèderont 3 semaines (renouvelables dans l’année) / séjours d’urgence – 2 places dont on évalue le taux d’occupation à 50% sur l’année (d’où la nécessité d’une habilitation pour 8 et une budgétisation effectuée pour 7). A signaler que la fermeture de la structure après 3 semaines de fonctionnement et pendant 1 semaine de récupération (annualisation du temps de travail des intervenants) constitue une garantie contre les risques d’installation de la personne et de pérennisation de son placement (dérive facile)
Résultat - lettre bilan d'Annick D
Nous avons saisi les nouvelles méthodes de travail du Conseil Général des Bouches du Rhône, avec ses commissions sectorisées. Nous étions dans le pôle Marseille Sud. Nous avons travaillé dans la commission « Innovations ». Participaient des grosses associations, Chrysalide and Co, quelques parents de jeunes adultes handicapés Nous avons pas mal cogité, lu
Nous avons été très réalistes aussi, … donc entre l’énervement et la presque désillusion !
Nous sommes allées visiter, pique-niquer même, dans une belle propriété Marseillaise. Nous avons été même presque des locataires dans un projet de vente immobilière.
On a fait « flop », une once face aux promoteurs ! Mais d’autres lieux on trouverait.
Septembre 2000, on nous fait retravailler la copie. Notre projet intéresse.
Décembre 2000, le CG donne ses résultats, c'est-à-dire les budgets accordés pour telle catégorie ou tel fonctionnement. La recherche d’une moins lourde institutionnalisation et d’une amplification de l’accompagnement d’une personne handicapée, dans son environnement proche, est la base de la volonté politique annoncée du CG
Nous sommes dans le ton, même un dièse plus haut !!! On attend notre courrier avalisant notre projet
Janvier 2001, notre projet n’a pas été retenu, bien qu’il soit super, juste, intéressant etc … dixit le CG
On nous annonce alors un motif tombé du ciel pour nous : le CG s’occupe des gens à partir de 21 ans. Or Jérémie va en avoir 18
Nous avions en préambule du projet raconté l’histoire de Jérémie. Nous posions la question de « l’après », pour des gosses comme lui, futurs adultes
Quelle vie pour lui ? La même c’est à dire l’intégration et l’évolution dans notre société
Quelle vie pour les parents ? La poursuite de l’apprentissage en douceur de la séparation, retrouver des souffles
Nous avons réinterrogé le CG et … le motif essentiel est évidemment d’ordre financier. Ces structures coutent cher et la rentabilité n’est évidemment pas assurée, si l’on considère la souplesse intrinsèque de notre proposition. L’expérience, les désirs, le gout d’un certain art de vivre, tous ces mots n’ont pas fait le poids.
Le CG a quand même retenu le concept de l’accueil temporaire mais à quel « prix » ?
-des places saupoudrées dans des établissements existants …
-pour des adultes pas trop handicapés (les comme Jéjé c’est pour l’Etat : en quelque sorte adressez-vous plutôt à la DDASS)
GROSSE DECEPTION … CONTINUER …
C’est possible, il y a une piste
Il faut qu’on se bouge encore …"
2003-2004 Le troisième projet : l’accueil temporaire relais – projet pluri associatif
Le contexte
Notre participation au Pôle Territorial Marseille Sud de Parcours Handicap 13 nous a permis de rencontrer d’autres associations ressources en terme de recherche et de projet. On nous invite fortement à nous rapprocher de partenaires potentiels.
En l’occurrence du CASIM (Comité d’Action Sociale Israelite de Marseille) qui se sent équipé pour être gestionnaire d’un projet comme le nôtre (ils ont déjà un financement privé pour démarrer – mais pas d’écrit achevé et de validation des tutelles).
Nous avons le sentiment d’offrir notre projet comme base de réflexion.
Nos partons ensemble sur l’idée d’un accueil relais, forcément temporaire
PROJET PARTENARIAL DE CREATION D’UN SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE
POUR ADULTES HANDICAPES
Résumé du projet
-
Historique :
-
Le projet :
-
L’application :
- soit un séjour de loisirs offrant des vacances dans un cadre attractif et sécurisant,
- soit un séjour de rupture offrant momentanément en relais un « ailleurs », à une personne en difficulté dans son milieu de vie.
- Soit un séjour d’urgence offrant une prise en charge immédiate, dans une situation familiale. ou sociale imprévue
Résultat
Tout laissait penser que ce projet allait enfin voir le jour :
- 2003 c’est l’année des Handicapés
- L’accueil temporaire se développe dans tout le Nord Ouest de la France et se réfléchit au niveau législatif
- Le Conseil Général des Bouches du Rhône nous confirme valider notre projet comme projet innovant
- une association déjà gestionnaire d’équipements est d’accord pour créer ce service avec nous (le Casim)
Mais voilà, là encore, de l’idée à la réalisation il se trouve parfois des embûches…inattendues
Après un an de travail et d’élaboration, nous ne retrouvons plus « nos billes »
- Nous découvrons notre projet dans des publications israélites mais notre nom comme association partenaire a complètement disparu !!!
- Par contre, nous n’avons pas crié gare quand le CASIM a introduit les 2 autres associations de même obédience (Handicap amitié culture -cercle Elie Wiesel- et Aurelia).
- Les handicapés accueillis deviennent uniquement des personnes intelligentes avec un handicap moteur ; relégué le handicap mental ???
- Tous les écrits sont modifiés autant dans le fond que dans la forme sans notre accord
- Apparait une véritable monopolisation cultuelle (l’accueil se fera dans la confession juive)
- Notre projet est vidé de son âme. Universalité, intégration, laïcité …
Nous dénonçons ce partenariat fantôme, et malhonnête
Très déçus nous quittons la scène des bien pensants
Et entrons dans le vif du sujet en réalisant en 2004 puis 2005 deux camps improvisés, bricolés
avec Jéjé, Mehdi, Bertrand et Samuel ,
ce sera « NOS » premiers accueils temporaires
2006-2007- Le quatrième projet : l’accueil temporaire vacances adaptées organisées
Le contexte
Après l’échec de notre projet avec le CASIM nous entrons à notre échelle dans le vif du sujet et démarrons des camps d’été pour ceux qui nous concernent, avec ceux qui sont concernés.
deux camps bricolés à l’été 2004 et 2005, qui font l’unanimité
Cette expérience 2 années de suite nous donne des ailes pour
- formaliser un peu plus le camp d’été 2006, peaufiner le compte rendu
- oser une demande de subvention officielle, en particulier au Conseil Général
- préparer le dossier pour obtenir de la préfecture l’agrément vacances adaptées organisées, nouvelle obligation imposée à toutes les associations et structures qui organisent des séjours de vacances pour adultes handicapés (séjour supérieur à 3 personnes handicapées sur 5 jours)
- relancer un grand projet structuré d’accueil temporaire pour jeunes et adultes handicapés : vacances en groupe en centre de vacances de l’économie sociale. Nous sommes soutenus par un chercheur de projet de la fondation du Crédit Coopératif. Il nous encourage à voir les choses en grand. Et nous prépare à passer les différentes étapes de la sélection (longue et sévère)
PROJET D’ACCUEIL TEMPORAIRE POUR JEUNES ET ADULTES HANDICAPES :
VACANCES EN GROUPES, EN CENTRES DE VACANCES DE L’ECONOMIE SOCIALE – REGION CONCERNEE SUD EST – PACA
Résumé du projet
- le temps et «l’ effet vacances »
- D’une part, c’est l’importance de l’implication et de la mobilisation du réseau propre
- D’autre part, c’est l’importance de l’implication et de la mobilisation du réseau d’accueil
- De l’économie du sujet à l’économie sociale
- Modules d’accueil vacances intégrés
-
- -d’une semaine (renouvelable)
-
- -pour 6 adultes (ou adolescents) porteurs d’un handicap lourd,
-
- -qui vivent prioritairement toute l’année dans leur famille (et non en internat institutionnel),
-
- -et qui vont séjourner dans un centre de vacances du tourisme social, de tradition et de structure associative, coopérative ou mutualiste
-
- -y être accueillis au sein même d’une unité collective de vie à caractère familial et/ou amical
-
- -accompagnés et encadrés par une équipe de 9 accompagnants (avec un coordinateur responsable) émanant pour la plupart de l’entourage proche (ou du noyau environnemental) de la personne handicapée : tierces personnes salariées déjà par eux-mêmes ou leurs familles), volontaires associatifs indemnisés, personnes bénévoles proches
Nous avons observé que les personnes lourdement handicapées qui vivent chez elles sont généralement isolées, en dehors de leurs parents proches et de leurs aidants. Or, leur noyau familial ou social, n’est, à la base et en général, potentiellement pas moins important et pas moins riche que pour tout individu lambda. C’est le handicap souvent qui a désactivé ce noyau : d’abord les turbulences émotionnelles liées à la situation, puis l’éloignement qui s’installe et finalement se pérennise. Or notre pari est que ce réseau est toujours là, et que, sollicité, aidé, facilité, il peut se réactiver et trouver compétence et sens à être là, un tout petit peu plus présent, un temps dans le module par exemple (une partie de pêche avec un vieux tonton …), un poste à part entière dans le module par exemple (le stage BAFA de la copine du petit frère …). Nous sommes convaincus que la connaissance de la personne handicapée pendant le module, le décodage de ses comportements, la lecture de ses désirs … doit permettre un après et un ailleurs à cette relation naissante. NB : nous avons coupé tout le phasage du projet sur 3 ans, les budgets prévisionnels
- Résultats attendus
- Perspectives : multiplier et essaimer
Résultat
On fait un premier camp, formel cette fois, en été 2006
On ne pouvait espérer une validation définitive de notre projet qu’en 2007 lorsque le Crédit Coopératif aurait fédéré des partenaires financiers sur la région PACA
En même temps on sait qu’on nous a réclamé un projet pour une réalisation d’envergure …ce qui, disons le, nous stresse et nous tétanise un peu
En attendant on se dit : que ça morde, que ça traîne des pieds, ou que ça trébuche, il va falloir démarrer concrètement l’organisation déjà d’un séjour de 2 modules consécutifs (soit 15 jours), pour cet été 2007
Au préalable nous obtenons de la Préfecture en mai 2007 « l’agrément vacances adaptées organisées », C’est un précieux sésame qui nous donne le droit d’organiser des séjours de vacances pour personnes handicapées, mais aussi de demander des subventions conséquentes. Cependant c’est aussi une première formalisation qui nous oblige à déclarer nos camps, notre taux d’encadrement, la qualité des encadrants, notre organisation, nos mises à disposition de contrôles alimentaires sanitaires etc etc etc. Bref on sort un peu de notre petite cuisine interne
Notre projet d’accueil vacances (une à deux semaines consécutives à la demande) se réalise entre le 30 juin et le 14 juillet 2007, pour 6 adultes handicapés et 6 accompagnateurs dans le même esprit que lors des précédents séjours.
Le choix du Village Vacances a été déterminé en fonction des critères fondamentaux suivants: mer ou arrière pays plutôt que montagne, intégration en Village Vacances plutôt que gîte, structure adaptée (personnes handicapées) et conviviale (restauration, animation, piscine). Le choix final possible a été porté sur le VVF VAL de Méjannes le Clap dans le Gard
Au final disons-le nous ne franchirons jamais les dernières étapes, à savoir : repenser notre projet
- avec une amplification et une multiplication de séjours anonymisés
- ouverts à toute personne lamda qui s’inscrirait, seule, sans son réseau, via la MDPH
- et en partenariat avec des entreprises locales repérées et pérennes justifiant d’un « donnant donnant ».
Nous allons apprendre, ou plutôt vérifier que finalement nous ne choisirons jamais de changer d’échelle, préférant rester centré sur notre petit collectif fédéré d’histoires de rencontres et d’amitiés, et fédérateur à son tour de solidarité et de bienveillance élargies.
Nous ne sommes décidément pas des bâtisseurs de cathédrales…
Et pendant ce temps, Jérémie …
- sur 4 jours en mai, la « Fête à jéjé »
- sur un week-end en octobre, la course Algernon à Marseille (nb : ces 2 manifestations sont très fréquentées ( 100 à 150 participants)
- Il y a les retrouvailles pour les AG (en janvier, en septembre, parfois aussi en juin)
Le relais est difficile pour elle, après les 4 années de Xavier et sans le support que représentait l’école
Comme activités il y a :
La piscine très régulièrement
Le cheval avec Charles à Eoures 2 fois par semaine au foyer occupationnel les chênes, et petite boom après avec les résidents
Le repas le midi 2 fois par semaine à l’auberge de jeunesse où il retrouve les enfants Freinet
Des balades
Les colos et le centre aéré avec le centre social Mer et Colline puis le centre social du Roy d’Espagne
Et le sentiment quand même que les institutions sociales se cachent derrière leur devoir de responsabilités pour garder porte close (ex : les clubs 3° âge – ne nous offrent qu’un temps pour participer à une répétition chorale)
Alors c’est vrai on a parfois le sentiment de meubler le temps
Et puis la vie nous joue parfois des vilains tours qui nous laissent un peu chaos Mémé Boubou, la fidèle grand-mère de Jéjé, décède brutalement fin 1999 : Jérémie s’arrête souvent à l’époque pour fixer sa photo, approcher délicatement sa bouche. Qu’a-t-il compris ?
Puis c’est autour de Valerian de nous quitter en décembre 2001, Valérian, un de « nos » gamins saisi par la malchance pour lequel chacun à notre place on n’a peut être pas pris en compte l’immensité de sa solitude.
puis c’est Danièle qui s’en va en décembre 2002, elle qui, au milieu de toute sa fragilité, avait une franche fidèle et touchante générosité de cœur pour Jérémie
Michelle arrive pour travailler avec Jéjé en mars 2002, après le départ de Stéphanie. Elle arrive avec son petit monde vivant des quartiers nord dans lequel elle emmène régulièrement Jérémie (NB : 22 ans plus tard … Michelle est toujours là !)
Eté 2002 : pour la première fois c‘est le cadeau de 15 jours de vacances pour Annick et Henri grâce à Martine et Jean Marie qui emmène Jéjé avec eux 1 semaine dans la Haute Loire et auront ensuite l’inconfortable mission de le laisser pour la 2° semaine à un organisme de vacances lambda pour personnes polyhandicapées (ouh là là – quelle détresse) Et pendant toutes ces années Le cercle autour/avec jérémie s’agrandit, et se pérennise :
- Mehdi nous accompagne de loin en loin depuis le début, du fait de notre amitié avec Nunzia et Gilles qui l’accueillent
- Bertrand, grenoblois comme on l’a été, devient un fidèle des regroupements « fête à Jéjé »
- Manon marseillaise, comme on est devenu, apparait à son tour
- Et en 2004 voilà un petit nouveau qui arrive : Samuel de Montpellier
On a croisé Jean Philippe une paire d’années
et quelques autres…
En 2004 c’est notre premier petit camp improvisé, bricolé avec Jéjé, Mehdi, Bertrand et Samuel
Idem en 2005
En 2006 c’est notre premier camp formalisé
En 2006 aussi c’est la modification de l’objet social de l’association qui devient : « gérer un mouvement de solidarité autour de personnes handicapés et être pour elles et avec elles force de propositions et de réalisations de projets » (toujours d’actualité) 2007 : c’est l’arrivée de Vulco auprès de Jéjé, un amour de labrador d’assistance, parti trop tôt et qu’on regrette encore. C’est lui qui nous emmène avec Jéjé chaque jour en balade dans les collines de Luminy. Tous ces rendez vous quotidiens alliés aux rendez-vous pluri annuels de l’Asso jalonnent la vie de Jéjé.